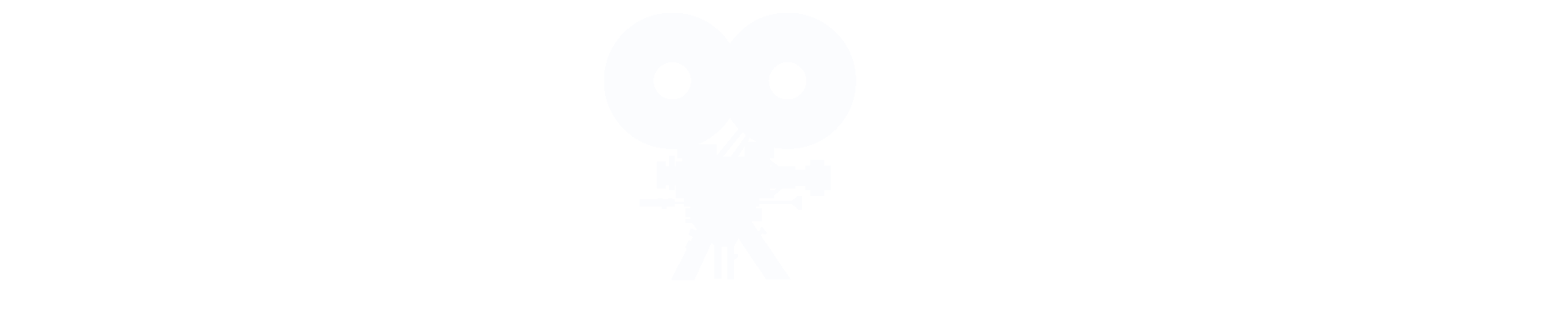Critique par Luca Califano
Il n’est jamais chose aisée de faire un remake d’une œuvre culte de la pop culture. Nombreux et nombreuses ont été les auteur·rice·s à s’être essayé·e·s à ce périlleux exercice de jonglage entre pertinence artistique, travail de modernisation, affirmation de sa vision en tant que réalisateur·rice et avis tranchés des fans, avec plus ou moins de réussite selon les cas. C’est pourtant à cet exercice que s’est prêté le réalisateur britannique Edgar Wright – réalisateur notamment de Scott Pilgrim, de la trilogie Cornetto et de Baby driver – en réadaptant le livre de Stephen King, adapté une première fois sur grand écran en 1987 par Paul Michael Glaser, Running man. Qui de mieux que ce réalisateur nerd, dont on connaît son amour profond et sincère pour la pop culture, pour prendre à bras le corps ce remake de ce film devenu avec le temps un film culte de science-fiction des années 80. Trente-huit ans après la sortie du film original – et quarante-deux ans après Le Prix du danger d’Yves Boisset, film franco-yougoslave qui a largement inspiré, voire selon certains carrément été plagié par Running Man – l’histoire de ce héros contraint de survivre à un jeu télévisé macabre au cœur d’un régime totalitaire revient sur grand écran avec panache et style, jusqu’à son dénouement final…

Dans les premières décennies du XXIᵉ siècle, les États-Unis ont sombré dans une dictature où la télévision et les médias sont devenus l’instrument absolu de contrôle des masses. Un programme capte désormais l’attention de tout le pays : Running man. Un jeu télévisé à l’audience colossale, bâti sur la violence et le voyeurisme, où 3 prisonnier.ère.s doivent survivre pendant un mois, chassé.e.s par des “traqueurs”. Ben Richards, un homme brisé par le système et blacklisté par le régime, accepte de participer à cette compétition meurtrière pour aider sa famille en détresse financière. Son but : survivre en échappant à ces chasseurs impitoyables, lâchés à ses trousses dans un pays où le spectacle fait foi.
Pour commencer, il faut constater qu’Edgar Wright réussit le pari de dépoussiérer l’œuvre originale. En effet, le long métrage sorti en 1987 et porté par Arnold Schwarzenegger s’est considérablement effrité avec le temps. Avec l’œil critique d’aujourd’hui, Running man nous vient comme une œuvre extrêmement divertissante, plutôt goufi, mais remplie de pépins scénaristiques et d’un propos sous-exploité. Sans entrer dans une analyse détaillée de l’œuvre, Running man reste néanmoins un film très sympathique et généreux, mais manquant concrètement à exploiter son potentiel subversif dans son propos. Bref, pour le dire simplement: ça avait pris un méchant coup de vieux. Des éléments que Wright avait compris dès le départ quand ce dernier a pris le lead du projet. Par sa mise en scène dynamique, spectaculaire, rythmée par une musique prenante et divertissante qui caractérise si bien la patte du réalisateur britannique – qu’on avait pu découvrir dans sa pleine expression dans Baby driver – l’œuvre réussit à moderniser le matériel de base. Le tout en gardant cette explosivité généreuse. Une mise en scène d’action plus qu’honnête, remplie d’idées de mise en scène qui nous plonge dans une narration parfaitement maîtrisée en terme de rythme et qui réussit à attraper le/la spectateur.ice dès le début de son récit sans jamais le/la lâcher tout du long. C’est véritablement ce tempo narratif qui constitue l’une des qualités principales du film, en réussissant parfaitement à maîtriser son rythme narratif effréné, métaphorisant par le montage la sensation de sprint effréné du personnage principal, et en ralentissant quand cela est nécessaire pour apporter de la profondeur au récit.
Tout en gardant l’idée générale et le propos de fond (sur lesquels nous reviendrons après plus en détail), le film se permet véritablement de faire des choix de différenciations importants par rapport au film sorti quarante ans plus tôt. Pour évoquer les deux éléments centraux, on peut d’abord souligner la temporalité profondément remaniée : la traque de Ben Richards ne s’étend plus sur vingt-quatre heures, mais sur un mois entier de chasse effrénée. Cette durée élargie permet au film de s’affranchir de l’espace clos du premier opus et d’explorer une palette de décors beaucoup plus vaste. Cependant, la grande différenciation se trouve dans la caractérisation des traqueurs, où leur spécificité et leur côté haut en couleur passent à la trappe. Malheureusement, pas de Subzero, cliché un tantinet raciste d’un Asiatique en patin à glace. Pas de Captain Freedom, avec ces jolis petits collants flashy. Pas de Dynamo, aussi répugnant que lumineux avec sa panoplie de petites LED. Pas de Buzzsaw, qui mélange le fétichisme masculiniste parfait entre la moto-cross et les tronçonneuses. Et pas de Fireball, interprété par le fantastique Jim Brown, nous jouant ses meilleures têtes de méchant constipé. Ici, adieu à ces méchants exubérants pour les remplacer par des mercenaires bien plus sobres, vêtus de tenues paramilitaires des plus standard. Mis à part l’antagoniste Evan McCone, qui se paye le luxe et la folie d’avoir une cagoule avec des lunettes, les autres chasseurs restent sobres, pour n’être qu’une masse de super soldats surentraînés. Un choix compréhensible, puisqu’il s’inscrit dans la volonté de rendre les antagonistes plus crédibles et menaçants, mais qui perd malheureusement ce grain déjanté qui apportait une véritable saveur au film de base. Il me semble que ce choix retire l’un des éléments forts du film original qui reposait beaucoup sur la découverte des différents traqueurs tout au long du récit, tous plus fous les un que les autres. Ici, avec ces méchants génériques et plus insipides, on perd une richesse qui aurait pu en réalité elle aussi être modernisée en gardant à la fois ce côté excessif télévisuel et la violence macabrement comique du récit. Une démarche de légèreté loin d’être abandonnée par le film, qui garde un pied dans ce bain comique. Ces choix pourront être perçus positivement ou non selon les spectateur.rice.s, mais, nonobstant, cette rupture et ces éléments de différenciation avec le film précédent sonnent comme une note permettant à l’œuvre de se construire non pas au reflet du film précédent, mais avec sa propre singularité.

Toutefois, hormis la réalisation globale du film qui constitue un fondement essentiel de qualité du film et les différents partis pris du long métrage, c’est bien dans son propos de fond que le film excelle bien mieux que son prédécesseur. Là où le film de 1987 posait un contexte d’une société totalitaire et militariste dans une société capitaliste, sans forcément les développer plus que ça, le Running man de 2025 pousse plus loin l’approfondissement de cette société dystopique. L’œuvre nous dépeint plus en détail des États-Unis capitalistes où l’exploitation du peuple et l’aliénation favorisent une minorité dominante. La population est sous le joug de la domination bourgeoise qui, comme le théorise Gramsci, use de l’hégémonie culturelle par les médias, et notamment via des émissions de télé comme Running man, pour assujettir la population à l’ordre établi. Les opprimés sont, à la différence de l’œuvre originale, non pas dépeints comme des masses stupides et guignolesques, mais comme des individus qui subissent, qui survivent, qui s’organisent et qui tentent de résister dans cet univers. Les dominés ont concrètement un visage et ne sont pas juste une sorte de toile de fond. Indubitablement, le film porte dans son propos une ligne anti-autoritaire, antimilitariste, antifasciste, pointant du doigt l’aliénation des masses par les médias bourgeois et dénonçant les dérives mortifères du système capitaliste. Un film qui a d’ailleurs la volonté de s’inscrire dans un contexte bien actuel par un ensemble de références et de clins d’œil au réel, comme la ressemblance frappante de certaines émissions présentes dans la diégèse. On peut donner l’exemple de cette parodie de l’émission Les Kardashian tournant en ridicule comme un contenu abrutissant très populaire au sein des classes populaires.
Un point qui illustre véritablement cette lecture du film se retrouve dans la caractérisation du personnage principal. Dans l’œuvre de Michael Glaser, le personnage de Ben Richard, interprété par notre cher ami autrichien Schwarzenegger, est un soldat qui a désobéi aux ordres injustes de sa hiérarchie. Dès le départ, ce personnage nous est construit comme une masse de muscles. Un dieu vivant, portant évidemment l’aura de Schwarzy, capable d’anéantir tous ces ennemis par son expérience de commando. À l’inverse, Wright prend le contrepied de cela en construisant le personnage de Ben Richard comme un ouvrier blacklisté par le pouvoir pour avoir communiqué des informations sensibles à des militants syndicalistes, le plongeant lui et sa famille dans une précarité profonde. Le personnage principal n’occupe pas le sommet de la pyramide sociale, mais en représente la base. Ben Richard est un travailleur, en opposition à la société d’exploitation dans laquelle il se situe et c’est pour cela que cette même société tente de le détruire. Ce qui est intéressant, c’est que sa force, son intelligence et sa débrouillardise émanent directement de ces expériences en tant que travailleur dans ces lieux de travail. Là où Schwarzenegger était surpuissant parce que c’est Schwarzenegger, Ben Stiller, interprété par un Glen Powell en pleine forme, s’est construit par la pénibilité et la dangerosité du travail capitaliste. Permettant de créer un parallèle pertinent entre le travail salarié et les shows TV où la vie des candidat.e.s est mise en jeu. La puissance du protagoniste est l’incarnation de la force ouvrière et le corps du héros incarne la violence du système. Cela en va de même pour sa rage. Sa colère n’émane pas de rien, mais elle est issue de la violence symbolique que lui-même et sa famille subissent au quotidien. Un lien familial développé avec la caractérisation de sa femme qui est obligée de travailler en tant que street tiseuse dans un bar miteux et leur fille atteinte d’un simple rhume pouvant lui être fatal à cause du manque de moyens pour la soigner. En somme, il ne s’agit pas d’un soldat brutal, mais d’un simple prolo qui tente, par la force, de briser ces chaînes. La violence systémique est mère de la résistance qui guide l’action des protagonistes dans le récit.
En revanche, pour être nuancée, il faut nous abstenir de surinterpréter la substance du film, en la percevant comme radicale. En effet, dire que l’œuvre porte en elle une lecture marxiste ou libertaire serait une erreur. Malgré que le métrage dépeigne cette société d’exploitation où les groupes privés contrôlent la société, le film ne porte pas une lecture stricto sensu de classe et n’a pas la volonté d’avoir une analyse marxiste de l’oppression. Un positionnement d’ailleurs clairement revendiqué par le film, avec cette scène dans laquelle le symbole du Che Guevara et le Mort aux vaches (symbole anarchiste) sont tous deux rejetés au profit d’une toile blanche. Par cette scène, le film annonce à ses spectateur.ice.s qu’il se détache politiquement de ces positionnements idéologiques. Running man ne prend pas le parti de filmer un collectif qui s’organise pour s’émanciper, mais se concentre sur une figure héroïque qui inspire les foules et pousse un mouvement révolutionnaire. Un mouvement révolutionnaire de masse qui n’est concrètement à aucun instant caractérisé politiquement. Ben Richard est la révolution. Il est un symbole de liberté, d’espoir et d’émancipation. Le processus révolutionnaire si cher aux penseur.euse.s marxistes et libertaires n’est pas le cœur du film, mais reste en toile de fond aux actions du héros. Pour ces raisons, on peut catégoriser le film comme un film plutôt libéral dans sa manière de théoriser la contestation qui, même s’il prend le parti d’être offensif envers un ensemble d’éléments de domination, ne va pas détailler sa critique de ces structures dominantes. Cette nouvelle proposition se révèle plus politisée que son prédécesseur en affirmant une vision plus nette. Celle d’une émancipation et d’une résistance face au système, tout en soulignant le rôle central de la télévision dans la formation de la pensée collective. Néanmoins, cette orientation reste encore bien trop timide.

En somme, si on devait s’arrêter à cela, Running man serait très certainement l’une des œuvres les plus jouissives de cette année 2025. Une proposition filmique remplie d’idées visuelles intéressantes, un montage percutant, une explosion de plaisir et une vraie réflexion dans son propos. Une œuvre parfaitement construite, riche en matière, qui démontre une réflexion minutieuse de ce projet qui a été pris avec un très grand sérieux par un auteur qui a étudié et adapté avec sa vision le matériel de base. Toutefois, c’est bien dans son final que le film fait défaut. C’est bien le cas de le dire! Dans ces 20-30 dernières minutes, le film s’écroule complètement dans un chaos scénaristique total. Dans sa clôture, on se retrouve dans une succession d’éléments scénaristiques et de nouvelles thématiques ajoutées de manière expéditive, sans le moindre développement et ne servant ni à la narration ni au propos. Il est clair que l’œuvre est incapable de fermer les différentes lignes narratives construites tout au long de son récit et tente de raccorder tous les wagons scénaristiques de manière désordonnée. On se retrouve au final devant un ensemble d’éléments parfaitement exécutés qui n’aboutissent, pour la plupart, sur rien de substantiellement conséquent. Cette incapacité de finir correctement son histoire fait ressortir les lacunes d’écriture qui parsèment le film. Des personnages et des éléments thématiques sous-exploités, voire non utilisés. Le constat est malheureusement cinglant: Edgar Wright ne savait pas comment terminer son film. Ce faux pas est d’autant plus frustrant qu’il a tendance à éclipser les grandes qualités du film, laissant à la sortie de la salle un sentiment de frustration et d’amertume au spectateur.ice.

En définitive, il est possible de dire que le Running man de 2025 réussit à surpasser le Running man de 1987. Le film, visuellement inspiré, réussit à insuffler une énergie nouvelle à cette histoire, qui aura au fil des années inspiré de nombreuses autres créations. Le film réussit sa mission de modernisation intelligente du matériau d’origine, tout en affirmant bien plus son discours politique. Une œuvre généreuse, prenante, souvent jubilatoire, où la dénonciation des dérives médiatiques et de l’exploitation systémique trouve un écho particulier aujourd’hui. En dépit de cela, on retrouve une véritable dichotomie entre les grandes forces du film et son chapitre final tout bonnement mauvais. Ce final chaotique, incapable de refermer correctement son intrigue et ses thématiques, vient ébranler l’ensemble de l’édifice filmique. Ce déraillement final n’annule en rien les qualités indéniables du film, mais il empêche considérablement Running Man d’atteindre pleinement l’ambition qu’il s’était fixée. Il demeure toutefois un spectacle intensément maîtrisé, inventif, traversé par un souffle politique assumé, et animé par un vrai désir de cinéma qui caractérise si bien la carrière d’Edgar Wright.
Luca Califano
Réalisateur: Edgar Wright
Acteurs et Actrices : Glen Powell, Josh Brolin, Lee Pace, Katy O’Brian, Michael Cera
Distribution : Warner Bros
Date de sortie: 19 Novembre