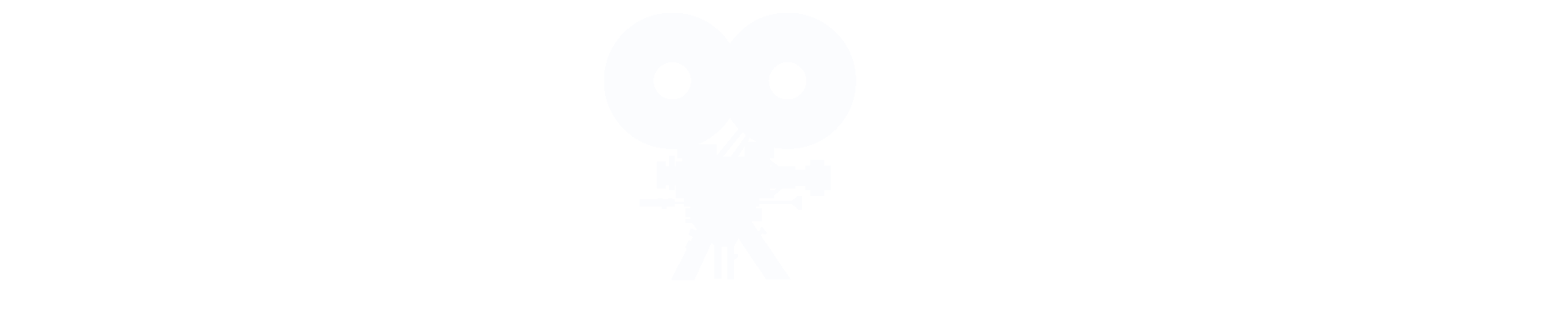Klaus Kinski. L’artiste dément, impétueux, colérique, odieux, ambitieux, détestable, caractériel… L’acteur prend ici la tête du navire et s’engage dans une navigation chaotique et délirante dans l’espoir d’arriver à son film ; « Kinski Paganini ».
Avant toute chose, sans surprise, ici encore, il est à préciser que l’importance et l’attention qui seront accordées à Klaus Kinski (1926-1991) en tant qu’artiste ne feront pas office de validation des déboires de sa vie personnelle, en aucun cas acceptables ni tolérables. Cette focalisation centrale se justifie par l’importance des rôles divers qu’occupe l’artiste dans la conception et la production du métrage, autant devant que derrière la caméra (il est le réalisateur, le monteur, l’auteur et le protagoniste de l’œuvre abordée). Son art, ses ambitions d’artiste et ses méthodes seront le point central de l’article, de la même façon qu’il est lui-même le nombril de son œuvre (et la cause de beaucoup de ses problèmes).
Il sera ici question des deux versions existantes du film, la version cinéma (81 min) comme sa version Director’s cut (88 min), les deux trouvant un intérêt à mes yeux de par les différences de structure qui les définit. La première, à mon sens, tâchant de donner sens à la seconde, en essayant de restructurer du mieux possible son expressivité pour la rendre un minimum compréhensible et un peu plus accessible) Le film ne sera pas uniquement abordé de façon critique, mais l’étude de ses nombreuses facettes permettra de se poser un certain nombre de questions sur ce qui fait l’essence d’un auteur et le rapport qu’il entretient avec la technique et l’expression.
Le film raconte à sa façon l’histoire du musicien Niccolò Paganini, incarné par Klaus Kinski, et retrace ses succès musicaux, ses déboires personnelles, sa vie familiale, son rapport à son art et à sa carrière.

Fruit d’une production chaotique, suite au refus de Herzog de réaliser le film, Kinski se décida à porter lui-même le fardeau du projet, qui signera son premier, dernier et unique film en tant que réalisateur.
Le film, hanté par la figure mégalomane de Klaus Kinski à la production comme à l’image, souffre grandement de cette omniprésence et des ambitions démesurées et pathétiques de son auteur. Les problèmes y abondent, les intentions (souvent ridicules, ou d’un « mauvais-goût » vulgaire) débordent de cette œuvre difforme, sans la sauver pour autant de son impossible échec. En résulte un nanar involontaire, tellement sérieux qu’il en devient grotesque, bien plus kinskien que paganinien (comme le laissait présager le titre).
L’acteur, par souci d’authenticité probablement (et problème mégalomane ?) souhaitant à tout prix transmettre ses intentions sans intermédiaire, indépendamment des difficultés qu’implique l’exercice, a décidé de tourner en italien plutôt que d’avoir recours à un doubleur. On retenait de l’artiste une maestria de la langue de Goethe absolument phénoménale, ce qui lui permettait lors de déclamations dans cette dernière une fluidité et liberté tout à fait admirable, ici non-atteinte avec l’italien (malgré un très haut niveau pour un germanophone).
Peut-être pensait-il qu’on aurait souffert d’un doublage, qui nous aurait fait oublier le ton voulu, et éloigné de l’authenticité, que seul la voix de l’Auteur Créateur pourrait transmettre ; ces décisions potentielles questionnent le principe même du doublage ; est-il problématique que la voix de l’acteur se ainsi que son ton soient substitués à ceux d’un autre, créant une potentielle incohérence, ou un changement de volonté peut-être incompatible avec celles de l’acteur initial ? Ou peuvent-ils être égalés par quelqu’un d’autre ? Le résultat plus qu’approximatif proposé au spectateur suggère une réponse par la négative dans ce cas présent, la qualité d’un bon doublage par autrui primant de façon évidente sur une volonté que la technique ne soutient pas.
De façon analogue, il apparaît également assez évident que, malgré toutes les bonnes volontés du monde, Kinski est incapable de jouer du violon. Si le métier d’acteur implique d’être crédible dans le rôle qu’il incarne, et de faire croire à ce que l’on ne fait pas, ou ce que l’on ne peut pas faire, on peut considérer les performances mimées du musicien comme du mauvais jeu d’acteur, puisque son incapacité technique transparaît de façon évidente, la simulation n’étant pas crédible. Cependant, rappelant alors l’énergie d’un amateur qui, malgré ses faiblesses techniques, laisse paraître toute sa volonté dans son art, cette dévotion intense et furieuse que l’on observe sur le visage de l’acteur permet, volontairement ou non, la création d’une certaine atmosphère, et illustre le pathétique caprice d’un enfant mégalomane.
L’artiste y est vu comme un être tourmenté. Le musicien joue jusqu’à la mort, côtoie les hautes sphères de l’art, délaisse le corps en faveur de l’esprit. Cette figure de l’artiste inspiré abonde tant qu’on peine à ne pas la rattacher à l’acteur même qui l’incarne (rien que sa présence en tant que protagoniste le suggère), que l’on savait totalement dévoué à la cause artistique, et dont on perçoit ici les limites du pathétique écrasant, d’une lourdeur prétentieuse à toute épreuve.

On notera une douceur extrêmement marquée du personnage de Paganini envers son fils (alors incarné par Nikolai Kinski, véritable fils de Klaus Kinski). Il le regarde avec tendresse, lui enseigne le jeu d’échecs, tel un père aimant et bienveillant. L’auteur construit autour de son personnage (et, ainsi, autour de lui-même), une aura de tendresse et de bonnes intentions qu’il ne peut être que maladif et répugnant d’observer de la part d’un père dont les déboire sont désormais connus (viols, maltraitances et autres crimes impardonnables). On pourrait voir en cette identification au personnage de Paganini une sorte d’auto-excuse et tentative de justification malsaine de ses sévices, prétendument expliqués par une dévotion artistique auto-destructrice sans limites.
Il devient difficile de tracer la frontière qui sépare Kinski Paganini de l’un ou de l’autre, et deviner si (ou plutôt quand ?) l’œuvre est plus centrée sur l’artiste qui la signe ou s’il s’agit d’une réelle tentative d’adaptation sincère de la vie et des tourments de Paganini, ou alors, la plus plausible à mon goût, un détournement desdits tourments pour les rattacher à l’auteur qui l’incarne. L’auteur va jusqu’au bout de son délire, quitte à ce que l’on s’y perde et qu’on ne puisse le suivre, s’érigeant en génie incompris et s’affirmant explicitement en héritier direct de la légende paganinienne. (Point à retenir : être un artiste n’excuse pas tout, et l’ambition seule ne fait pas le résultat.)
Lorsqu’on veut faire sans savoir-faire

Il semble y avoir peu à sauver de ce film, dont on retient davantage les intentions que le résultat lui-même. On se souvient de la formule de Werner Herzog, à propos de sa collaboration avec Kinski, expliquant qu’il ne faisait que donner « une direction au chaos ». Ici, c’est bel et bien la direction qui manque, à l’acteur (définitivement en roue-libre) aussi bien qu’au métrage, l’absence de direction (et de finesse dans l’écriture) anéantissant sa portée émotionnelle. Le métrage en souffre presque autant que le spectateur, fatigué de voir déferler un tourbillon aussi brutal et bordélique, voire sans intérêt par moments.
Le film sera un échec à sa sortie, aussi bien critique que commercial, que son auteur tentera de défendre avec la virulence qu’on lui connaît, (comme en témoigne la fameuse crise de son réalisateur lors d’une séance de presse à Cannes, suite au visionnage du film (alors non-terminé) par le jury, sans l’accord de son auteur, et du refus de sa sélection pour le festival).
On ressort toutefois du film quelques beaux costumes, de beaux décors, quelques plans mémorables de beaux moments musicaux (notamment des performances incroyables des pièces du musicien qui donne son nom à l’œuvre par Salvatore Accardo), ainsi que quelques travaux esthétiques mémorables, qui se perdent hélas dans cette masse difforme.
Peut-être inspiré par l’Amadeus de Milos Forman, sorti 5 ans plus tôt, dont il n’atteint cependant ni l’équilibre tragique, ni la force de l’hommage, Klaus Kinski propose ici une thématisation de la figure de l’artiste et de ses intentions, fascinante de maladresse, éblouissante d’expression (certainement trop, ça en devient indigeste), tant marquée d’intentions que celles-ci viennent percer la pellicule tel des violents coup de couteaux… Expérience cinématographique singulière, mais plutôt désagréable, Kinski Paganini dépasse le nanar, c’est une navigation improbable que commande un capitaine fou et inexpérimenté, mégalomane trop sûr de lui, se livrant dans son délire à une traversée tourmentée et tempétueuse, en rendant l’intention encore plus fracassante et spectaculaire que son naufrage (qui le sauve de l’oubli). Fascinant. Un pur délire kinskien.



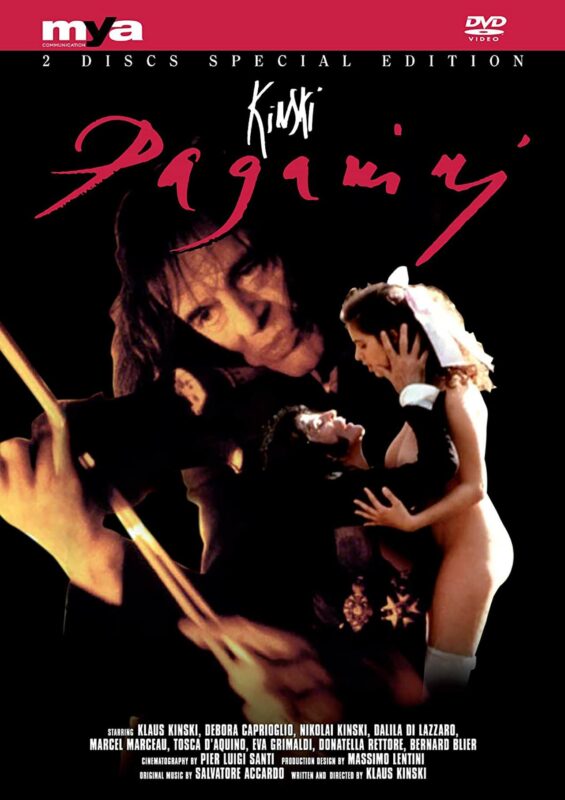





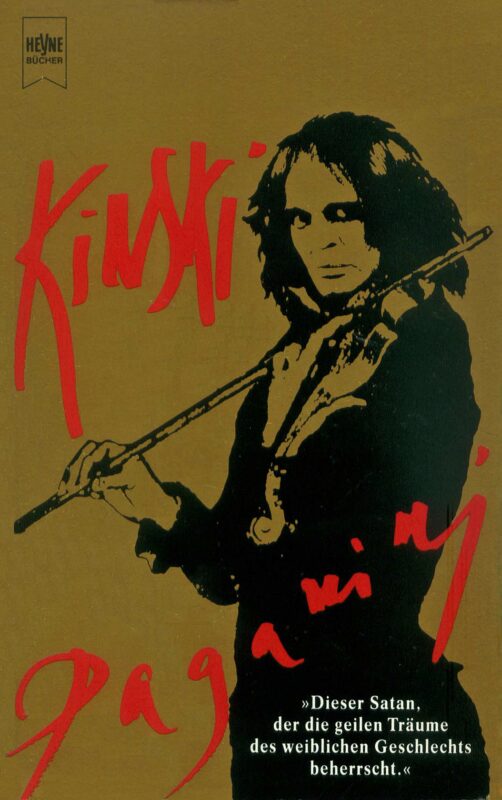




Kinski Paganini (Paganini Kinski/Paganini)
Italie/France – 1989 – 81 min [version cinéma] – 95 min [director’s cut]
Réalisé par Klaus Kinski
Avec Klaus Kinski, Nikolai Kinski,